L’association BRUDED est un réseau de plus de 140 collectivités de Bretagne et Loire-Atlantique qui s’engagent dans des réalisations concrètes de développement durable et solidaire.
Son objectif : montrer que c’est possible !
Parmi ses modes d’action, des publications inspirantes et ultra-pragmatiques. La dernière en date nous parle forcément puisque le sujet est la restauration collective durable, un de nos sujets de prédilection, et que se retrouvent dans ces pages deux projets que nous avons eu le plaisir d’accompagner :
- Breizh Alim’, une démarche d’animation de filière pour une commande publique économiquement responsable – Conseil Régional de Bretagne
- Des produits locaux dans les assiettes des petits mordellais – Commune de Mordelles
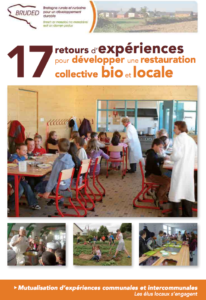 Ce document présente un panel d’actions concrètes portées par des communes et intercommunalités pour favoriser des restaurations collectives durables et locales, valorisant les ressources des territoires.
Ce document présente un panel d’actions concrètes portées par des communes et intercommunalités pour favoriser des restaurations collectives durables et locales, valorisant les ressources des territoires.
Objectif: témoigner de la diversité des moyens d’action, et donner envie à d’autres élus d’expérimenter des solutions innovantes pour favoriser une approche globale en matière d’approvisionnement bio et local des restaurants collectifs.
Au delà du simple recueil d’expériences, ce document apporte des pistes de réflexion mais aussi des leviers d’action très concrets.
Par exemple, 7 facteurs de réussite pour passer à l’action sont détaillés :
- Des élus au cuisinier : associer tous les acteurs à la démarche pour démontrer que c’est possible
- Régie, DSP: quelle démarche adopter selon le mode de gestion de votre cantine?
- Approvisionnement-logistique: trouver les produits dans les quantités désirées, et limiter le temps passé aux commandes et livraisons
- Réglementation et recommandations nutritionnelles : des adaptations possibles
- Coûts : une approche globale pour réaliser des économies
- Marchés publics : traduire la volonté politique dans la commande publique
- Pour des repas appréciés par les enfants : favoriser le plaisir de bien manger
A noter tout de même, dans le facteur n°6, parmi les très bons conseils, un conseil à ne surtout pas appliquer est donné « Diviser certains lots pour être inférieurs aux seuils de publicité (25000 € HT) et privilégier une procédure de gré à gré en s’appuyant sur plusieurs devis ».
Il existe en effet dans le décret relatif aux marchés publics une règle dite des « petits lots » qui induit souvent en erreur les personnes non aguerries au langage juridico-juridique (voire totalement imbuvable il est vrai) des marchés publics. En effet, cette règle permet seulement de passer en procédure adaptée les petits lots d’une procédure formalisée. En aucun cas elle n’autorise le gré à gré, dès lors que le besoin relatif à une famille d’achat (les denrées alimentaires en l’occurrence) est estimé supérieur à 25 000 € HT par an.
Le calcul du montant à comparer aux seuils n’est pas si simple, nous vous en parlions ICI.
Ainsi, l’acheteur doit veiller à ne pas scinder artificiellement ses besoins pour se soustraire à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Il pourra toutefois ensuite s’il le souhaite passer plusieurs consultations (ou une consultation allotie), afin d’ouvrir au maximum son besoin, mais il doit bien se référer au montant total pour connaître le type de procédure à appliquer.
Mais l’enjeu de l’achat ne se situe pas là et nous perdons souvent une énergie précieuse à disserter sur la notion de famille d’achat. Nous pensons qu’il est plus utile de mettre son énergie à la définition du besoin et des critères d’attribution afin de sélectionner les meilleurs prestataires que de rechercher une échappatoire à tout prix. Essayer de contourner les règles de la commande publique est risqué (pas que d’un point de vue juridique) et surtout peu vertueux, particulièrement lorsque l’on prône une démarche responsable.
A l’Agence Déclic, nous assurons la conformité réglementaire, et au delà, nous expérimentons, innovons, modernisons. Les marchés publics ne sont pas une contrainte (Peut-on réellement dire que les règles visant à faire un bon usage des deniers publics sont une contrainte ?). Nous pensons qu’ils sont un outil, et que comme tout outil, il faut apprendre à s’en servir.
En ce qui concerne les marchés liés à la restauration collective, voici nos conseils pour une recette savoureuse et réussie :
Etapes à suivre :
1.Connaître précisément la politique de la collectivité en terme d’achats responsables
Faire le point avec les élus sur leurs souhaits en terme de qualité, de dimension sociale, environnementale, économique
2.Faire un état des lieux
Dans une perspective de développement durable, l’acheteur aura tout intérêt à mener un état des lieux précis :
- Types de produits utilisés et en quelles quantités
- Démarches déjà engagées en matière de qualité reconnue (label rouge, bio, équitable…) ou respect d ela saisonnalité (essentielle en ce qui concerne les produits frais)
- Contraintes opérationnelles du restaurant en matière de préparation
- Bonne connaissance des attentes des convives
- Aspiration des cuisiniers et de leur équipe
3.Connaître l’offre locale
Une bonne connaissance de l’offre locale (produits, fournisseurs, volumes, saisonnalité…) permet de cibler les possibilité d’achat de proximité.
Entretenir des relations régulières avec les fournisseurs locaux permet de mieux connaitre leurs contraintes et de mieux leur faire connaître celles d’une cuisine collective
4.Trouver la forme d’achat qui correspond le mieux à son cas
Passer ses propres marchés, avoir recours à une centrale d’achat, rejoindre un groupement de commande (et pourquoi pas le piloter)
5. Ne pas prendre les marchés publics comme une contrainte mais comme un outil
Bien utilisés, les marchés publics permettent de sélectionner de façon objective les fournisseurs répondant le mieux aux besoins et attentes de la collectivité. Cela nécessite de se former, voire de se faire accompagner dans cette démarche.
Comment valoriser (et non favoriser) les producteurs locaux ?
- Définir son besoin et ses attentes
- La règle de base : l’allotissement (certainement l’exercice le plus délicat)
- La durée du marché : une durée raisonnable
- Autoriser les variantes
- Faire une publicité adaptée
- Définir le niveau de qualité attendu pour chaque produit (qualité nutritionnelle, gustative, origine, fraicheur, etc)
- Savoir quels modes de production sont souhaités (s’ils ont un impact sur la qualité des produits)
- Définir le niveau de service attendu (conditionnement, livraison, suivi administratif etc)
- Prendre en compte la saisonnalité
- Valoriser le travail des fournisseurs responsables en adaptant les critères d’attribution : fraicheur des produits, qualité, saisonnalité, démarche environnementale etc.
- Utiliser la multi-attribution pour sécuriser les approvisionnements
Crédits photos : Unsplash – Bruded – Agence Déclic